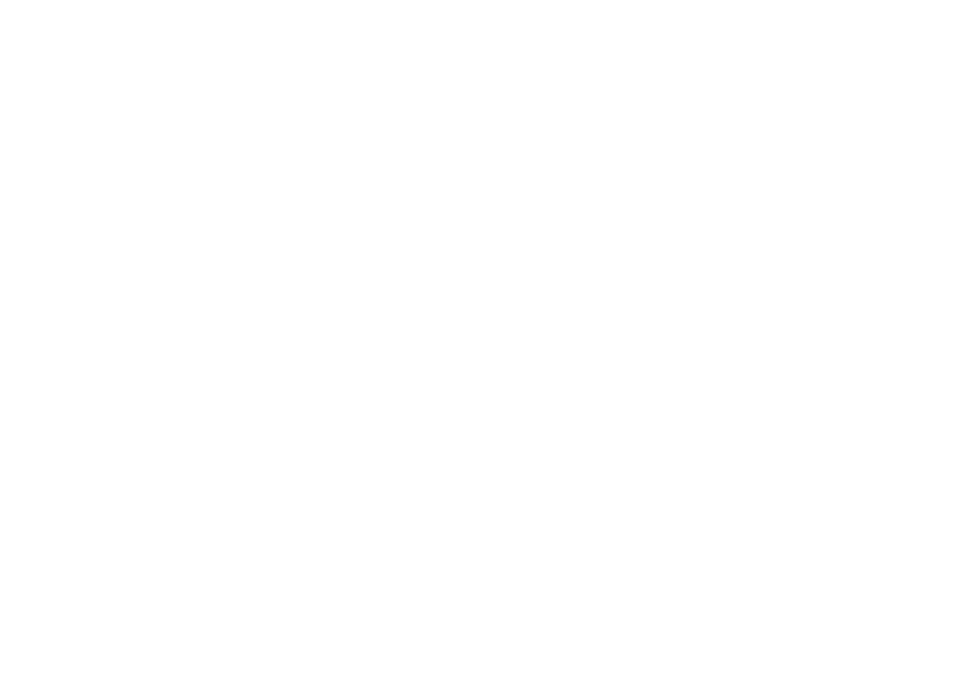DAVIKEN STUDNICKI-GIZBERT EST PROFESSEUR ASSOCIÉ AU DÉPARTEMENT D’ HISTOIRE DE MC GILL.
Il se consacre depuis plusieurs années à l’étude et l’analyse des enjeux entourant l’industrie minière canadienne, en s’intéressant à la fois à l’histoire et à l’expansion de cette industrie et à ses impacts sur les communautés où elle opère.
Il coordonne notamment le MICLA, un collectif de recherche étudiant la question des activités minières des compagnies canadiennes en Amérique latine.
Daviken est intervenu le 25 mai 2010 dans une conférence organisée par le PAQG et au cours de laquelle était présenté le témoignage de Javier de Leon, autochtone guatémaltèque et acteur privilégié de la lutte sociale qui s’opère en réponse aux activités extractives menées par l’entreprise minière canadienne Goldcorp dans la région de San Miguel, au Guatemala.
 PAQG- QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE DE FAÇON GLOBALE L’ACTIVITÉ MINIÈRE MENÉE PAR LES ENTREPRISES CANADIENNES DANS L’ENSEMBLE DE L’AMÉRIQUE LATINE?
PAQG- QU’EST-CE QUI CARACTÉRISE DE FAÇON GLOBALE L’ACTIVITÉ MINIÈRE MENÉE PAR LES ENTREPRISES CANADIENNES DANS L’ENSEMBLE DE L’AMÉRIQUE LATINE?
D.S.G- C’est un peu cela que le MICLA tente de déterminer. Un élément qui revient toujours, c’est la dynamique local versus global. La nouvelle technologie minière est caractérisée par une concentration d’énergie, de ressources financières, et par des impacts environnementaux très localisés et intenses. Une grande compagnie minière comme Goldcorp ou Barrick est constituée de très peu de personnel, souvent 3 ou 4 personnes, tandis que ce qui l’alimente est une espèce de toile très étendue, qui inclus les citoyens, les fonds de pensions, les fonds d’investissements, etc. Tous ces efforts se concentrent sur un territoire bien précis, où les dégâts sont énormes et intenses. Dans les conflits générés par cette industrie, ce ne sont pas les États, ni même des acteurs nationaux comme des syndicats qui réagissent, mais bien les communautés affectées.
Le très local et le très global sont mis en relation en cet espace d’exploitation minière. On est donc face à une asymétrie sans pareille, dans la relation sociale qui confronte une entreprise minière à une communauté locale, celle-ci le plus souvent rurale, autochtone, marginalisée ou avec tous les indicateurs sociaux qu’on leur connaît souvent.
Il existe aussi un nœud politique; qui a le droit de déterminer ce qui peut ou non se passer sur un territoire donné? D’une part, dans la plupart des États, les ressources naturelles relèvent du fédéral, du domaine national. D’autre part, on a la présomption de penser qu’il est juste, éthique et moral que les personnes affectées au plan local aient un contrôle sur les projets miniers.
Dans les faits, ce nœud politique n’est donc pas résolu, malgré le travail d’organismes comme le PAQG qui appuient les communautés.
Ce sont quelques-uns des points communs à tous les cas, mais on ne trouvera jamais un contexte pareil, réunissant tous les mêmes facteurs, à travers les 1200 à 1500 projets miniers existant en Amérique latine1.
PAQG- QU’EN EST-IL DES MOUVEMENTS DE RÉSISTANCE ET DES REVENDICATIONS DES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES UN PEU PARTOUT EN AMÉRIQUE LATINE?
D.S.G- Ce qui est universel, c’est que tout membre d’une communauté aspire à avoir un degré de contrôle sur le projet minier. Il existe toutefois un large spectre de revendications, allant de la cessation complète des activités minières, à la création d’emplois, ou le paiement de redevances par l’entreprise. Les réactions sont donc très variables, mais il existe un pattern universel : il y a toujours des divisions dans la mobilisation. Le diviseur est l’argent, puisqu’on parle de sommes incroyables, et que beaucoup de gens voudraient bien tirer leur épingle du jeu. En Argentine, on voit une importante mobilisation qui vise à contrer la division, à développer un consensus, une solidarité, une cohésion pour mieux faire face au projet minier. À Tambogrande au Pérou, ou à Andagala en Argentine, le mécanisme de consultation populaire a servi aussi de véhicule à l’éducation, au dialogue, pour mener une sorte de conversation à l’intérieur des communautés affectées.
Mais dans une foule d’autres contextes, les conditions ne sont pas réunies pour faire une consultation et permettre un dialogue, parce que la compagnie est déjà trop imbriquée dans le tissu social, en train de faire son travail de « développement social » qui est souvent une façon de diviser les gens. Il existe même, dans les entreprises, des documents expliquant ce qui doit être fait pour diviser la communauté2; des stratégies décrivant par exemple à quels membres de la communauté on doit parler pour créer une division. Certaines compagnies engagent des anthropologues pour « radiographer » la communauté avant d’y pénétrer, histoire de mieux comprendre qui sont les acteurs présents. Avec une communauté divisée, il est facile de mener une production sans problèmes.
Quand un projet arrive à sa phase concrète, la compagnie a intérêt à entrer et commencer le plus vite possible, sans laisser le temps aux paysans de s’informer et de s’organiser en résistance.
Une fois que l’activité minière est commencée, il est beaucoup plus difficile de l’arrêter ou de la réformer, car la division est déjà créée : ils se sont déjà ralliés certains membres de la communauté, et les autorités étatiques, nationales ou fédérales sont déjà dans le jeu.
On remarque aussi qu’en général, les communautés autochtones sont beaucoup plus cohésives et capables de s’organiser pour résister et/ou négocier. Elles sont plus radicales, et plus portées à rejeter en bloc l’exploitation minière. Les autochtones protègent leur territoire et ont une conscience historique très forte, après avoir vu des étrangers piller leurs ressources pendant plusieurs siècles. Les projets miniers qui ont engendré les confrontations les plus fortes se situent dans les régions autochtones : le Chiapas, Oaxaca et Guerrero au Mexique, le Guatemala, l’Équateur et les zones autochtones du Panama, par exemple.
Il existe deux chemins principaux pour les communautés s’opposant à un projet minier : l’un est très difficile à réaliser en raison de tous les intérêts qui s’y opposent, mais la solution en est simple : il s’agit d’en arriver à un moratoire, ou à une interdiction.
L’autre chemin est facile à emprunter, et l’industrie lui est évidemment plus favorable, c’est-à-dire celui de la négociation, mais il est difficile d’en arriver à une entente satisfaisante.
Mais de quoi avons-nous besoin pour entreprendre une négociation, pour vraiment connaître quels seront les impacts dans un monde ou même les scientifiques ou les géologues ne le savent pas? Personne ne se préoccupe d’une manière scientifiquement sérieuse des impacts. Les compagnies mènent des études d’impacts environnementaux sans aucune transparence, inaccessibles au public, ou qui ne tiennent pas debout scientifiquement.
Ajoutons à cela que c’est une question très complexe du point de vue géophysique et que toutes les mines sont très différentes. Pour réellement connaître les impacts, cela nécessite à la fois du temps et de l’argent, deux choses que les entreprises minières n’ont aucune envie de donner si ça ne leur est pas imposé. L’entreprise minière veut produire. Les dirigeants le disent eux mêmes: ce n’est pas leur travail de développer des communautés, ils le font parfois, dans différentes mesures et avec différents degrés de sincérité, mais ils ne sont pas là pour ça. Ce qu’un projet minier va rapporter à la communauté qu’il affecte ne dépend pas de la taille du projet, des capacités financières de l’entreprise qui le mène, ni de la production d’or ou d’un autre métal : cela dépend de la capacité de la communauté à s’organiser pour le demander ou l’imposer, et à avoir une certaine emprise sur l’entreprise et le projet.
PAQG- LE CONCEPT DE RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES EST-IL SUSCEPTIBLE D’ÊTRE UN OUTIL POUR LES ENTREPRISES ELLES-MÊMES PLUTÔT QUE D’AMÉLIORER LES CONDITIONS DES COMMUNAUTÉS AFFECTÉES PAR DES PROJETS MINIERS?
D.S.G.- Il n’y a pas de devoir, de droit, de cadre juridique qui force les entreprises à quelque chose. Les discours et la pression autour que l’idée que les corporations devraient être plus responsables, sont une bonne chose, mais rien là-dedans n’a le statut d’obligation, rien n’oblige non plus à la continuité des pratiques au sein d’une même entreprise à travers les années. On retombe donc dans les jeux de pouvoirs et de force de la relation complètement asymétrique qui existe entre une compagnie minière et une communauté. Le discours sur la responsabilité sociale corporative s’étend dans le milieu des entreprises depuis quelques années, et est récupéré aussi bien par Walmart, Bombardier ou Hydro-Québec que par les entreprises minières. « Nous sommes, comme vous, des citoyens; des citoyens corporatifs qui allons prendre nos responsabilités. » On engage un conseiller, on met un individu en charge
des affaires socio-environnementales, mais cette part n’est pas intégrée dans le fonctionnement de l’entreprise. Et tout dépend du bon gré des entreprises, qui en réalité veulent faire avancer leur projet coûte que coûte. Elles utilisent donc les politiques sociales comme un instrument, un outil de propagande positive, pour pousser des campagnes médiatiques auprès des citoyens canadiens, des élus canadiens, des écoles de gestion, etc. Si par exemple une entreprise promeut la « participation d’une communauté à son propre diagnostic », qui peut dire non à ça? Pourtant il faut se rendre compte que dans un contexte où il n’y a pas de cadre politique ou juridique, ces mesures de responsabilité sociale ne servent qu’à l’industrie.
La loi C-300 ne changera pas le comportement des entreprises.
Le gouvernement du Canada pourra déterminer s’il appuie ou non, par le biais des ambassades, ou par de l’argent investi, des entreprises minières qui sont coupables de violations des droits humains. Mais ce qui se passe sur le terrain dépendra toujours du bon gré de l’entreprise, qui n’est obligée à rien.
PAQG- QUE PENSER DES ENTREPRISES MINIÈRES QUI JUSTIFIENT LEUR RÉTICENCE À EMPLOYER DES MÉTHODES PLUS RESPONSABLES PAR LA NÉCESSITÉ DE RESTER COMPÉTITIVES ET CONCURRENTIELLES?
D.S.G.- C’est du bluff. Ces compagnies opèrent très bien, même dans des contextes où on leur impose des mesures comme des études d’impact coûteuses. La marge de profits est tellement énorme dans l’industrie minière, où l’on va chercher en profits 3 ou 4 fois les coûts de la production, que ce genre de dépense est très abordable; pensons à une étude environnementale sérieuse, qui pourrait coûter entre 1 et 10 millions de dollars, dans le cadre d’un projet minier de 83 milliards de dollars3!
Ne pas le faire signifie qu’on veut continuer la production sans en connaître les impacts ni en assumer les responsabilités. C’est une question de perception du risque, et l’entreprise prendra des mesures plus « responsables » seulement si le fait de ne pas le faire menaçait son projet.
RÉFÉRENCE :
1 CETTE QUANTITÉ VARIE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE, ET CONCERNE TOUS LES PROJETS MINIERS MENÉS PAR DES ENTREPRISES BASÉES AU CANADA, QU’ILS NE SOIENT ENCORE QU’HYPOTHÉTIQUES, EN PHASE D’EXPLORATION OU D’EXPLOITATION.
2 INTITULÉ, PAR EXEMPLE, “FOMENTO DE LA DIVISION INTERNA DE LAS COMUNIDADES”
3 CE MONTANT RÉFÈRE À UN EXEMPLE RÉEL: CELUI DU PROJET MINIER DE GOLDCORP À PEÑASQUITO, ZACATECA, AU MEXIQUE